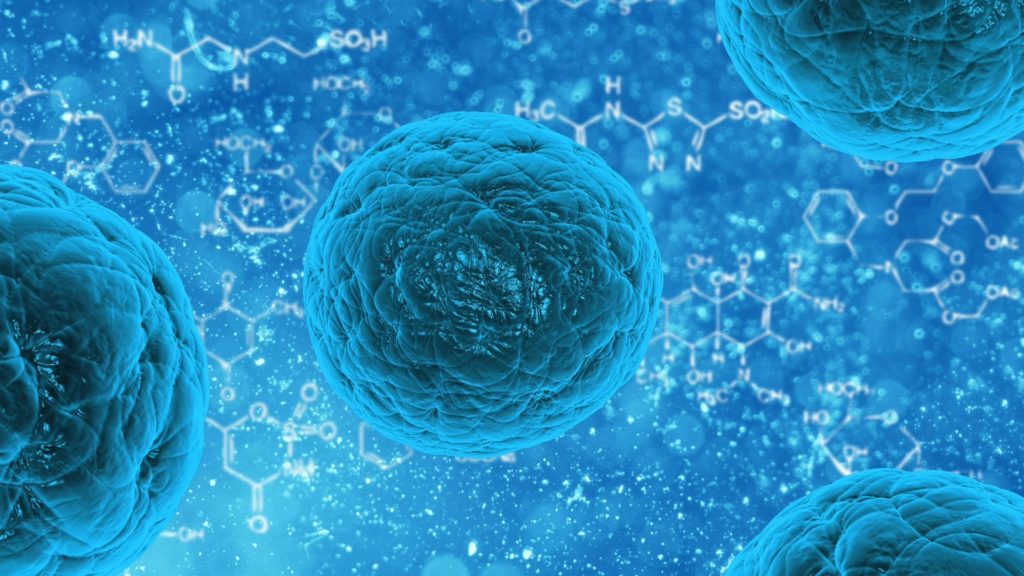Pour évaluer le risque lié à l’utilisation d’organismes en milieu confiné, il faut connaître la classe des agents biologiques utilisés et le type d’activité réalisée avec ces organismes. La classe d’une activité correspond en règle générale au groupe auquel sont attribués les organismes utilisés. On obtient ainsi un niveau de sécurité : 1,2,3 ou 4. On parle de laboratoire P1,P2, P3 etP4, en fonction de la classe du microorganisme pathogène, un laboratoire P4 utilise des microroganismes pathogènes du groupe 4. En anglais on parle de Biosafety level BSL, 1,2,3 ou 4. L’évaluation du risque conclut à un niveau de sécurité ( 1,2,3 ou 4) qui conditionne les mesures de sécurité à mettre en oeuvre tant au plan individuel que collectif.
Pour mémoire un risque correspond à la probabilité de survenue d’un évènement indésirable.
Attribuer l’organisme à un groupe
La classification des agents biologiques est établie par l’Ordonnance sur l’utilisation des organismes en milieu confiné (OUC, RS 814.912), elle-même établie sur la directive européenne 2000/54/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents biologiques au travail..
Cette classification établit quatre groupes d’agents biologiques :
Agents biologiques du groupe 1 :
« … n’est pas susceptible de provoquer une maladie chez l’homme »
Agents biologiques du groupe 2 :
« …peut provoquer une maladie chez l’homme et constituer un danger pour les travailleurs;
sa propagation dans la collectivité est improbable; il existe généralement une prophylaxie ou un traitement efficace »
Agents biologiques du groupe 3 :
« …peut provoquer une maladie grave chez l’homme et constituer un danger sérieux pour les travailleurs;
il peut présenter un risque de propagation dans la collectivité, mais il existe généralement une prophylaxie ou un traitement efficace »
Agents biologiques du groupe 4 :
« …provoque des maladies graves chez l’homme et constitue un danger sérieux pour les travailleurs;
il peut présenter un risque élevé de propagation dans la collectivité; il n’existe généralement pas de prophylaxie ni de traitement efficace »
De cette classification des agents biologiques découle une classification de risques des activités
Critères pris en compte pour classer les organismes
Pour étudier le risque, lié à la présence d’un organisme, pour l’être humain, les animaux et l’environnement, ainsi que pour la diversité biologique et l’utilisation durable de ses éléments,
on tiendra compte en particulier des critères suivants:
- la pathogénicité et la létalité;
- la virulence ou l’atténuation;
- le mode d’infection, la dose infectieuse et les voies d’infection;
- la production d’entités non cellulaires comme les toxines et les allergènes;
- les cycles de reproduction, les structures de survie;
- la gamme d’hôtes;
- le degré d’immunité naturelle ou acquise de l’hôte;
- le mode de résistance ou la sensibilité aux antibiotiques et autres agents spécifiques;
- l’existence d’une prophylaxie et de thérapies adéquates;
- l’existence de séquences d’acides nucléiques oncogéniques
- la mutagénicité;
- la production et l’excrétion de virus par des lignées cellulaires;
- les propriétés parasitaires;
- la contamination potentielle par des microorganismes pathogènes;
- les exigences en matière d’environnement;
- les expériences faites en Suisse ou à l’étranger lors de la propagation de cet organisme ou d’organismes étroitement apparentés (potentiel envahissant);
- l’existence de techniques appropriées pour rechercher, mettre en évidence, identifier, surveiller et combattre l’organisme concerné;
- potentiel d’utilisation à des fins malveillantes.
Pour étudier le risque lié à la présence d’un organisme génétiquement modifié,
on tiendra compte tant de l’organisme donneur, de l’organisme récepteur, du matériel génétique introduit (insert) et du vecteur ou du système vecteur-récepteur que de l’organisme génétiquement modifié lui-même, en se fondant en particulier sur les critères suivants:
- la fonction des modifications génétiques;
- le degré de pureté et de caractérisation du matériel génétique utilisé pour la recombinaison;
- les propriétés des vecteurs, en particulier en ce qui concerne leur capacité de réplication, leur gamme d’hôtes, la spécificité de leurs hôtes, l’existence d’un système de transfert, leur capacité de mobilisation et leur pouvoir infectieux;
- les propriétés des séquences de l’acide nucléique, en particulier les effets régulateurs sur la croissance des cellules, le cycle cellulaire et le système immunitaire;
- la production et la libération d’organismes et de principes actifs pharmaceutiques, d’allergènes ou de toxines par l’organisme génétiquement modifié;
- la stabilité et le niveau d’expression du matériel génétique recombinant;
- la capacité de mobilisation du matériel génétique recombinant;
- la pression de sélection du matériel génétique recombinant.
Pour étudier le risque, lié à la présence d’un organisme exotique, pour l’être humain, les animaux et l’environnement, ainsi que pour la diversité biologique et l’utilisation durable de ses éléments,
on tiendra compte en particulier des critères suivants:
- le cycle de vie et la reproduction, en particulier en ce qui concerne la reproduction asexuée, le temps de génération et le nombre de descendants;
- l’existence d’organismes hôtes dans l’environnement;
- les exigences en matière d’environnement et la capacité de survie, en particulier en ce qui concerne la tolérance au froid et la diapause;
- la contamination potentielle par des microorganismes susceptibles d’être pathogènes pour l’être humain, les animaux ou les plantes;
- l’invasivité et l’éviction d’espèces indigènes;
- le danger que présente l’organisme pour la santé de l’être humain, des animaux et des plantes en raison de son allergénicité, de sa pathogénicité, de sa toxicité ou de sa propriété de vecteur;
- l’atteinte à d’autres organismes, en particulier par une concurrence et une hybridation;
- la perturbation des cycles des matières;
- les effets sur les fonctions des écosystèmes;
- la résistance ou la sensibilité aux pesticides, aux herbicides ainsi qu’à d’autres agents;
- l’existence de techniques adéquates pour détecter et combattre l’organisme concerné dans l’environnement.
Classification des activités
Étude du risque
Pour étudier le risque présenté par les activités prévues impliquant des organismes en milieu confiné, on tiendra compte en particulier des critères suivants en se fondant sur les groupes auxquels les organismes sont attribués:
- la nature, l’ampleur et le but de l’activité, par exemple le diagnostic, la recherche, la production ou le stockage;
- la propagation géographique connue ou supposée et la fréquence, en Suisse, des organismes concernés ou de leurs hôtes et vecteurs et éventuellement du matériel génétique recombinant, sous une forme endémique, de manière naturelle, par colonisation, par reproduction ou par transfert génétique;
- la capacité de survie, de reproduction et de propagation des organismes en Suisse, en particulier la formation de structures de survie de longue durée;
- l’interaction des organismes concernés avec d’autres organismes et la participation à des processus biogéochimiques;
- la présence de l’hôte ou du vecteur en Suisse;
- l’influence de l’activité sur la pathogénicité, la détectabilité, la transmissibilité, la capacité de survie et de propagation, la virulence, la gamme d’hôtes ou le tropisme des organismes utilisés;
- l’influence de l’activité sur l’efficacité des vaccins, des antibiotiques, des agents antiviraux ou d’autres principes actifs à usage médical ou agricole contre des organismes pathogènes;
- le but de l’activité visant à produire de nouveaux organismes pathogènes ou de rétablir des organismes pathogènes éradiqués ou disparus;
- le potentiel d’utilisation des organismes pathogènes à des fins malveillantes.
Évaluation du risque
La classe d’une activité correspond en règle générale au groupe auquel sont attribués les organismes utilisés.Elle diffère toutefois du groupe auquel sont attribués les organismes lorsque l’étude du risque met en évidence, en se fondant sur l’activité et sur les conditions de l’environnement, un risque sensiblement supérieur ou inférieur au groupe auquel ont été attribués les organismes..
Une activité est attribuée à la classe 1
lorsque le risque qu’elle présente pour l’être humain, les animaux et l’environnement ainsi que pour la diversité biologique et l’utilisation durable de ses éléments est nul ou négligeable, en particulier lorsque l’échappement d’organismes hors du milieu confiné ne fait redouter aucun effet pour ces biens protégés, ou un effet négligeable.
Une activité est attribuée à la classe 2
lorsque le risque qu’elle présente pour l’être humain, les animaux et l’environnement ainsi que pour la diversité biologique et l’utilisation durable de ses éléments est faible, en particulier lorsque l’échappement d’organismes hors du milieu confiné fait redouter pour ces biens protégés un effet réversible limité.
Une activité est attribuée à la classe 3
lorsque le risque qu’elle présente pour l’être humain, les animaux et l’environnement ainsi que pour la diversité biologique et l’utilisation durable de ses éléments est modéré, en particulier lorsque l’échappement d’organismes hors du milieu confiné fait redouter pour ces biens protégés un effet irréversible mais limité.
Une activité est attribuée à la classe 4
lorsque le risque qu’elle présente pour l’être humain, les animaux et l’environnement ainsi que pour la diversité biologique et l’utilisation durable de ses éléments est élevé, en particulier lorsque l’échappement d’organismes hors du milieu confiné fait redouter des effets irréversibles pour ces biens protégés ou que la survenue d’épidémies entraînant des conséquences graves est possible.
Classes pour les activités suivantes
Classe 1
- les analyses d’échantillons de sol, d’eau, d’air ou de denrées alimentaires dans la mesure où il n’y a pas lieu de supposer que ces échantillons sont contaminés au point de présenter un risque accru pour l’être humain, les animaux ou l’environnement ni pour la diversité biologique et l’utilisation durable de ses éléments;
- les analyses d’organismes des groupes 1 et 2 issus de matériel biologique clinique ou autre, lorsque des organismes y sont décelés en utilisant une méthode directe ou indirecte sans multiplication, ou alors en produisant un léger enrichissement effectué uniquement dans des récipients fermés;
- les activités impliquant certaines souches d’organismes du groupe 2 dans la mesure où celles-ci se sont avérées, soit expérimentalement, soit sur la base d’une longue pratique, aussi sûres que des organismes du groupe 1.
Classe 2
Les analyses d’organismes issus de matériel biologique clinique ou autre à des fins de diagnostic, à l’exception des analyses au sens de l’al. 1, sont en règle générale attribuées à la classe 2.
Le diagnostic primaire d’organismes pathogènes pour les animaux des groupes 3 ou 4 peut, pour ce qui est des dérogations visées à l’art. 49, al. 2, OFE2, être attribué à la classe 2 lorsqu’on peut supposer que les échantillons ne contiennent très probablement pas d’organismes pathogènes.
Classe 3
Si des organismes pathogènes du groupe 3 sont enrichis à des fins de diagnostic et qu’il en résulte un risque accru pour l’être humain, les animaux et l’environnement ainsi que pour la diversité biologique et l’utilisation durable de ses éléments, cette activité doit être attribuée à la classe 3.
Classe 4
Si l’on travaille avec des organismes du groupe 4, l’activité doit en principe être attribuée à la classe 4. Si un diagnostic primaire d’organismes du groupe 4 issus de matériel clinique non inactivé est effectué en utilisant une méthode directe ou indirecte sans multiplication, cette activité peut être attribuée à la classe 3. Si des analyses supplémentaires sont réalisées sur le même matériel d’origine que celui qui comporte les organismes du groupe 4, l’activité doit être attribuée, dans tous les cas, à la classe
Vous pouvez lire également les articles suivants :
- Sécurité biologique : bases légales et ressources
- Tâches du responsable de la sécurité biologique
- Classement des microorganismes en 4 groupes
- 4 groupes d’agents biologiques
- Sécurité au travail et protection de la santé
Sites internet conseillés
- Utilisation de microorganismes – Identification des dangers et plan de mesures
- Notions de sécurité biologique : mesures de sécurité suivant la classe des laboratoires
- Tous les microorganismes et pathologies, sur le site HPCI, hygiène, prévention et contrôle de l’infection, Canton de Vaud,
- Responsables de la sécurité biologique : statut, tâches et compétences
- Mesures de sécurité biologiques
- Pathogen safety data sheets : Base de données, fiche pour chaque microorganisme (comporte également les équipements de protection individuelle nécessaires)
- EBSA, European biosafety association
- ABSA, American biosafety association
- OMS : Laboratory biosafety manual
- WHO Tuberculosis Laboratory Biosafety Manual
- WHO Biorisk management: Laboratory biosecurity guidance
- Laboratory Biorisk Management standard
- World Organization for Animal Health (OIE) « Guidelines for Responsible Conduct in Veterinary Research- Identifying, Assessing, and Managing Dual Use«
- IVBW International Veterinary Biosafety
- CDC Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories (BMBL) 5th Edition, CDC, U.S.A.
- Canadian Biosafety Standard (CBS) Second Edition, Canada
- Biological agents: Managing the risks in laboratories and healthcare premises, HSE, U.K.
- Guidance on Risk Assessment and Cost Benefit Analysis
- A Guide to Training and Information Resources on the Culture of Biosafety, Biosecurity, and Responsible Conduct in the Life Sciences 2019